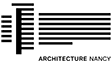Architecte invitée
Salima Naji
Architecte DPLG (Paris-La-Villette)
Docteure en anthropologie de l'EHESS
+ d'informations
BIO
Installée depuis 2008 dans le Sud marocain, Salima Naji défend une architecture ancrée dans son territoire, et qui en affirme la matérialité. Architecte Dplg (Ecole d'architecture de Paris-La-Villette) autorisée à exercer dans le royaume du Maroc depuis 2004, elle construit en réutilisant les matériaux biosourcés et les technologies de la terre ou la pierre dans une démarche d'innovation respectueuse de l'environnement.
Elle réinvestit ou perfectionne ainsi toutes les techniques vernaculaires pour une architecture contemporaine en mesure de proposer un développement soutenable appuyé sur les Hommes et une fine connaissance des territoires, en direction notamment de projets d'utilité sociale (maternités, centres culturels, foyers féminins, écoles, etc.) : elle espère ainsi réduire l'impact destructeur de l'architecture standardisée en béton armé actuellement généralisée. Ceci étant aussi une façon d'offrir aux plus démunis un espace public de qualité.
Docteure en anthropologie sociale (Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris), elle a consacré de nombreux ouvrages aux patrimoines bâtis du Sud marocain dans leur dimension intangible éminemment sociétale. L'intervention sur le bâti rural ancien convoque des institutions vivantes à revitaliser, et non pas une énième momification patrimoniale. Les transformations des espaces oasiens (ksours, kasbahs et greniers collectifs) sont questionnés à travers des programme de recherche-action comme "Preservation of sacred and collective oasis sites" (2006-2013) ou encore "Zerka, La source bleue et l'urbanisation des oasis de Méditerranée" (CRESSON, ENEC-La Sorbonne, HETS - HES-SO, Genève), impact environnemental et le bien-être des populations sur la longue durée. Membre de l'équipe scientifique qui a accompagné la création du musée berbère du Jardin Majorelle en 2011, Fondation Yves Saint-Laurent-Pierre Bergé à Marrakech.
Membre du réseau Mediterre, professionnel de la terre crue, elle est associée à divers laboratoires de recherche ou comités scientifiques.
Lauréate en 2004 de la Bourse « Jeunes architectes 2004 » de la Fondation EDF - Fondation de France ; elle reçoit en 2010 L'Hommage de l'ordre des architectes du Royaume par la cérémonie du « takrim ». Son travail a été remarqué à de multiples reprises notamment en 2011 par le Prix Holcim du Développement Durable (Catégorie Bronze Afrique-Moyen-Orient) et en 2013 par la Short list de l'Aga Khan Award for architecture.
Elle a reçu en 2017 l'insigne de Chevalier des Arts et des Lettres de la République française.
Elle réinvestit ou perfectionne ainsi toutes les techniques vernaculaires pour une architecture contemporaine en mesure de proposer un développement soutenable appuyé sur les Hommes et une fine connaissance des territoires, en direction notamment de projets d'utilité sociale (maternités, centres culturels, foyers féminins, écoles, etc.) : elle espère ainsi réduire l'impact destructeur de l'architecture standardisée en béton armé actuellement généralisée. Ceci étant aussi une façon d'offrir aux plus démunis un espace public de qualité.
Docteure en anthropologie sociale (Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris), elle a consacré de nombreux ouvrages aux patrimoines bâtis du Sud marocain dans leur dimension intangible éminemment sociétale. L'intervention sur le bâti rural ancien convoque des institutions vivantes à revitaliser, et non pas une énième momification patrimoniale. Les transformations des espaces oasiens (ksours, kasbahs et greniers collectifs) sont questionnés à travers des programme de recherche-action comme "Preservation of sacred and collective oasis sites" (2006-2013) ou encore "Zerka, La source bleue et l'urbanisation des oasis de Méditerranée" (CRESSON, ENEC-La Sorbonne, HETS - HES-SO, Genève), impact environnemental et le bien-être des populations sur la longue durée. Membre de l'équipe scientifique qui a accompagné la création du musée berbère du Jardin Majorelle en 2011, Fondation Yves Saint-Laurent-Pierre Bergé à Marrakech.
Membre du réseau Mediterre, professionnel de la terre crue, elle est associée à divers laboratoires de recherche ou comités scientifiques.
Lauréate en 2004 de la Bourse « Jeunes architectes 2004 » de la Fondation EDF - Fondation de France ; elle reçoit en 2010 L'Hommage de l'ordre des architectes du Royaume par la cérémonie du « takrim ». Son travail a été remarqué à de multiples reprises notamment en 2011 par le Prix Holcim du Développement Durable (Catégorie Bronze Afrique-Moyen-Orient) et en 2013 par la Short list de l'Aga Khan Award for architecture.
Elle a reçu en 2017 l'insigne de Chevalier des Arts et des Lettres de la République française.
Conversations à pied d'oeuvre par Salima Naji
Ethique de la préservation. Mémoire des lieux et compétence d'édifier dans les architectures oasiennes du Maroc
De la disparition de l'architecture des oasis au déni de civilisation
L'architecture des oasis se meurt. Héritière d'une civilisation de jardiniers-cultivateurs ayant élaboré de petites cités, reliées les unes aux autres par des routes commerciales multiséculaires, et s'égrenant parfois en chapelet, ou encore, ailleurs, de véritables villes ceintes, souvent établies sur d'anciens parcours caravaniers ; elle agonise depuis plusieurs décennies et semble aujourd'hui au Maroc condamnée définitivement. Pourtant, cette éclipse culturelle est artificielle : les procédés sont vivants, les lieux sont habités, les usages perdurent. Ils existent bel et bien et n'ont pas disparu comme on voudrait le faire croire. Les pratiques spatiales sont certes disqualifiées par des modèles venus d'ailleurs et pourtant elles se réactualisent et perdurent ici et là, résistent. Du moins tant que les murs qui portent ces pratiques immatérielles tiennent bon. Car dès que le bâtiment est détruit, il faut tout reconstruire et les modèles anciens une fois ruinés, sont rarement repris : les mises en oeuvre rigoureuses ont été, dans l'intervalle, délégitimées, de même que la gestion des espaces, fruit d'un façonnement anthropologique héritier de la longue durée. Ce qui a relié entre elles ces configurations sociétales diverses - nomades, semi-sédentaires, sédentaires - a été leur capacité, par le passé, à trouver des solutions neuves aux contextes dans lesquels elles s'étaient installées et aux changements qu'elles rencontraient. Et aujourd'hui, elles n'y parviendraient plus, dit-on. Elles auraient perdu cette résilience.
Comment des peuples qui, de tout temps, se sont toujours adaptés et ont toujours amélioré leur quotidien, seraient-ils soudain privés de cette capacité ? Alors que l'histoire nous comble d'exemples prouvant que toute société peut évoluer et qu'elle le fait le plus souvent sans renoncer à ce qui la caractérise, pourquoi la période actuelle exigerait-elle une rupture brutale avec tout héritage ?
Une amputation volontaire ?
Les zones sahariennes ont connu, depuis plusieurs décennies, une très forte croissance démographique qui s'est traduite avant tout par une forte croissance urbaine. Les petites villes historiques explosent passant de quelques milliers d'individus à plusieurs dizaines de milliers. La question des ressources est cruciale car les nouveaux quartiers se font régulièrement aux dépens des villes historiques, notamment ces fameux ksour souvent multiséculaires. Ces nouvelles cités, souvent construites en porte-à-faux avec les sites historiques, se déplacent sur les nouvelles routes goudronnées. Surtout elles viennent polariser les ressources en eau. Elles privilégient les activités commerciales légales ou illégales aux dépens des activités agricoles historiques ; cette « modernité » affichée, est facile, passive, face aux nécessités des entretiens agricoles ou des travaux agraires désormais délaissées car peu rentables.
Aura surgi en moins de deux décennies des formes bâties nouvelles – trop neuves – sans lien ni avec le passé ni avec les territoires où elles sont soudainement érigées. Comment cela a-t-il été rendu possible et pourquoi se propagent-elles ainsi partout, Maroc, Mauritanie, Mali, Sénégal, Algérie, Tunisie, Égypte, etc. ? Derrière la disparition de ces formes construites établies, incorporant tout un héritage de savoir-faire en architecture et en art du bâti, c'est un patrimoine immatériel, ce sont des pratiques qui s'étiolent ou disparaissent, violentées par de nouveaux registres de références ; des valeurs trop rapidement promues par des modernisateurs simplificateurs qui vont vite en besogne et qui ressentent le besoin de détruire. Détruire systématiquement. Pathologiquement.
Il faudrait donc éviter d'être dupe d'abord de ce qu'il faut bien se résoudre à appeler une automutilation : une amputation volontaire qui a commencé à se répandre en soufflant de nouvelles formes bâties, toujours édifiées en ciment, et toujours contre les matériaux locaux jugés dépassés et condamnés par la doxa comme irréversiblement inopérants. En détruisant le patrimoine, en venant superposer aux anciennes bâtisses des blockhaus de ciment, la poignée d'individus qui orchestrent ces mutilations volontaires dans les oasis croit appartenir à la modernité : elle ne veut plus se sentir reléguée dans l'arrière-cour des oubliés de la planète. Car, derrière beaucoup de ces opérations dites de « modernisation » - encore appelées « développement » - se cache aussi parfois la volonté de détruire, d'effacer des traces qu'on ne comprend plus et qui évoquent pour certains la misère. Mais, en même temps et surtout, ces transformations sont voulues et promues parce qu'elles induisent diverses formes d'enrichissement par la corruption. Contrairement à ce qu'on a dit parfois, il ne s'agit pas officiellement, ni consciemment, de détruire des formes de culture qu'on veut voir disparaître : il ne s'agit pas d'une épuration culturelle mais d'un processus plus complexe et plus sournois qui s'appuie sur l'ambition parfois honnête de résoudre certains problèmes sociaux, et développer les communautés, mais aussi éventuellement sur les possibilités d'enrichissement qu'offrent les projets de construction pour aboutir, hélas, aux mêmes conséquences car la résistance est inexistante.
L'autre blocage, le plus important, celui qui n'est jamais évoqué, celui qui se cache derrière une allusion aux préférences, aux raisons psychologiques ou liées à la représentation (la distinction sociale évidente), vient de cette forme de corruption tacite qui a érigé un système constructif comme unique modèle «inéluctable». Utiliser le parpaing de ciment est aussi un mode économique qui sied mieux aux contextes actuels, mais qui est loin d'être inéluctable.
Éthique de la préservation
J'ai senti très tôt que j'avais une dette envers ces sociétés complexes qui ont participé à ma formation en m'accueillant si souvent pendant que j'étais enfant, adolescente, jeune adulte, et aujourd'hui encore, et en me donnant le goût de leurs cultures et de leurs usages. Une dette envers tous ceux qui m'ont accueillie avec tant de générosité et de gentillesse tout au long de ces années dans leurs demeures, qui m'ont fait partager au quotidien ce qu'ils avaient de plus précieux : leurs valeurs. Une dette bien entendu aussi envers une architecture multiséculaire, creuset de mes réflexions de praticienne.
Ainsi ce qui m'est progressivement apparu comme une éthique de la préservation devait progressivement se mettre en place. J'ai élaboré et expérimenté, puis pratiqué une méthode de restauration en accord avec les communautés, une méthode réellement participative, gage de la réussite sur un long terme de projets conçus et réalisés par ceux qui les utilisent quotidiennement. Le plus important, assurément, dans la relation avec une communauté, c'est le respect : non pas un respect naïf qui acquiescerait à toutes les demandes, comme ces parents qui cèdent devant leur enfant capricieux et lui donnent un jouet inutile parce quu'il le réclame à cor et à cri ; mais un respect qui se projette dans les besoins de la communauté sur le long terme et qui cherche à identifier ce qui correspondrait à un mieux-être pour tous. Ce qui implique discussions, conflits, heurts parfois. Sensibilisations toujours, démonstrations ensuite par l'exemple. Mais aussi joies et réussites, avec la satisfaction du partage des espaces restaurés, tournés vers tous, dans un usage renouvelé. La question de la conversion architecturale est un champ ouvert qui se renouvelle pour chaque lieu à réhabiliter. Car ce patrimoine de Ksours (villages fortifiés), igudars (greniers collectifs) est un bien commun souvent habité ou utilisé. Derrière des murs, des architectures, ce sont des pans entiers de patrimoine immatériel qui disparaissent, des possibilités de mieux vivre et de mieux être aussi pour les populations. Ces biens inestimables sont irremplaçables. L'urgence est de sauver les monuments vivants que nous avons la chance de posséder encore au Maroc, mais aussi d'en conserver les procédés, les savoir-faire qui ont permis cette édification, le patrimoine immatériel qui le porte aussi, si fragile et si précieux tout en aidant les populations locales à mieux vivre.
Ecouter, convaincre, relever les architectures, mettre en oeuvre leur préservation
La génération des « modernistes » est fascinée par l'art du lisse, du clinquant, du lifting monstrueux qui transforme ce qui fait les spécificités d'un territoire en un masque gris, sans signes distinctifs. Mon travail essaie de rendre palpable l'idée d'une alternative possible. « Nous ne pensions pas, disent-ils en substance, qu'il était possible de faire aussi beau avec les héritages constructifs des aïeux ». Cette idée simple est une évidence en Europe, alors qu'au Maroc, aujourd'hui, elle tient du miracle. Créer véritablement ce qui répond à ses besoins propres et à son génie propre, à partir de ses spécificités en proposant sa propre voie, en rendant aux communautés leur dignité à travers l'architecture, une architecture résiliente, une architecture de l'adaptation.
Or, ce vieux pays est le produit d'une longue accumulation historique. Chaque monument peut être vu comme un trait de son visage. Tous sont uniques, mais ensemble ils forment un tout et donnent son caractère singulier à chaque territoire ; la diversité y devient générosité. Certains traits sont plus douloureux, ce sont des cicatrices rappelant une histoire malheureuse (la guerre, la misère) à peine refermée parfois, encore en souffrance ; avec le temps ils deviennent comme une ride, marqueur d'un âge vénérable, et ils n'évoquent plus que la sagesse. C'est là sans doute que doit se situer le geste architectural, le plus discret possible au service des êtres qui en sont les usagers premiers.
De la disparition de l'architecture des oasis au déni de civilisation
L'architecture des oasis se meurt. Héritière d'une civilisation de jardiniers-cultivateurs ayant élaboré de petites cités, reliées les unes aux autres par des routes commerciales multiséculaires, et s'égrenant parfois en chapelet, ou encore, ailleurs, de véritables villes ceintes, souvent établies sur d'anciens parcours caravaniers ; elle agonise depuis plusieurs décennies et semble aujourd'hui au Maroc condamnée définitivement. Pourtant, cette éclipse culturelle est artificielle : les procédés sont vivants, les lieux sont habités, les usages perdurent. Ils existent bel et bien et n'ont pas disparu comme on voudrait le faire croire. Les pratiques spatiales sont certes disqualifiées par des modèles venus d'ailleurs et pourtant elles se réactualisent et perdurent ici et là, résistent. Du moins tant que les murs qui portent ces pratiques immatérielles tiennent bon. Car dès que le bâtiment est détruit, il faut tout reconstruire et les modèles anciens une fois ruinés, sont rarement repris : les mises en oeuvre rigoureuses ont été, dans l'intervalle, délégitimées, de même que la gestion des espaces, fruit d'un façonnement anthropologique héritier de la longue durée. Ce qui a relié entre elles ces configurations sociétales diverses - nomades, semi-sédentaires, sédentaires - a été leur capacité, par le passé, à trouver des solutions neuves aux contextes dans lesquels elles s'étaient installées et aux changements qu'elles rencontraient. Et aujourd'hui, elles n'y parviendraient plus, dit-on. Elles auraient perdu cette résilience.
Comment des peuples qui, de tout temps, se sont toujours adaptés et ont toujours amélioré leur quotidien, seraient-ils soudain privés de cette capacité ? Alors que l'histoire nous comble d'exemples prouvant que toute société peut évoluer et qu'elle le fait le plus souvent sans renoncer à ce qui la caractérise, pourquoi la période actuelle exigerait-elle une rupture brutale avec tout héritage ?
Une amputation volontaire ?
Les zones sahariennes ont connu, depuis plusieurs décennies, une très forte croissance démographique qui s'est traduite avant tout par une forte croissance urbaine. Les petites villes historiques explosent passant de quelques milliers d'individus à plusieurs dizaines de milliers. La question des ressources est cruciale car les nouveaux quartiers se font régulièrement aux dépens des villes historiques, notamment ces fameux ksour souvent multiséculaires. Ces nouvelles cités, souvent construites en porte-à-faux avec les sites historiques, se déplacent sur les nouvelles routes goudronnées. Surtout elles viennent polariser les ressources en eau. Elles privilégient les activités commerciales légales ou illégales aux dépens des activités agricoles historiques ; cette « modernité » affichée, est facile, passive, face aux nécessités des entretiens agricoles ou des travaux agraires désormais délaissées car peu rentables.
Aura surgi en moins de deux décennies des formes bâties nouvelles – trop neuves – sans lien ni avec le passé ni avec les territoires où elles sont soudainement érigées. Comment cela a-t-il été rendu possible et pourquoi se propagent-elles ainsi partout, Maroc, Mauritanie, Mali, Sénégal, Algérie, Tunisie, Égypte, etc. ? Derrière la disparition de ces formes construites établies, incorporant tout un héritage de savoir-faire en architecture et en art du bâti, c'est un patrimoine immatériel, ce sont des pratiques qui s'étiolent ou disparaissent, violentées par de nouveaux registres de références ; des valeurs trop rapidement promues par des modernisateurs simplificateurs qui vont vite en besogne et qui ressentent le besoin de détruire. Détruire systématiquement. Pathologiquement.
Il faudrait donc éviter d'être dupe d'abord de ce qu'il faut bien se résoudre à appeler une automutilation : une amputation volontaire qui a commencé à se répandre en soufflant de nouvelles formes bâties, toujours édifiées en ciment, et toujours contre les matériaux locaux jugés dépassés et condamnés par la doxa comme irréversiblement inopérants. En détruisant le patrimoine, en venant superposer aux anciennes bâtisses des blockhaus de ciment, la poignée d'individus qui orchestrent ces mutilations volontaires dans les oasis croit appartenir à la modernité : elle ne veut plus se sentir reléguée dans l'arrière-cour des oubliés de la planète. Car, derrière beaucoup de ces opérations dites de « modernisation » - encore appelées « développement » - se cache aussi parfois la volonté de détruire, d'effacer des traces qu'on ne comprend plus et qui évoquent pour certains la misère. Mais, en même temps et surtout, ces transformations sont voulues et promues parce qu'elles induisent diverses formes d'enrichissement par la corruption. Contrairement à ce qu'on a dit parfois, il ne s'agit pas officiellement, ni consciemment, de détruire des formes de culture qu'on veut voir disparaître : il ne s'agit pas d'une épuration culturelle mais d'un processus plus complexe et plus sournois qui s'appuie sur l'ambition parfois honnête de résoudre certains problèmes sociaux, et développer les communautés, mais aussi éventuellement sur les possibilités d'enrichissement qu'offrent les projets de construction pour aboutir, hélas, aux mêmes conséquences car la résistance est inexistante.
L'autre blocage, le plus important, celui qui n'est jamais évoqué, celui qui se cache derrière une allusion aux préférences, aux raisons psychologiques ou liées à la représentation (la distinction sociale évidente), vient de cette forme de corruption tacite qui a érigé un système constructif comme unique modèle «inéluctable». Utiliser le parpaing de ciment est aussi un mode économique qui sied mieux aux contextes actuels, mais qui est loin d'être inéluctable.
Éthique de la préservation
J'ai senti très tôt que j'avais une dette envers ces sociétés complexes qui ont participé à ma formation en m'accueillant si souvent pendant que j'étais enfant, adolescente, jeune adulte, et aujourd'hui encore, et en me donnant le goût de leurs cultures et de leurs usages. Une dette envers tous ceux qui m'ont accueillie avec tant de générosité et de gentillesse tout au long de ces années dans leurs demeures, qui m'ont fait partager au quotidien ce qu'ils avaient de plus précieux : leurs valeurs. Une dette bien entendu aussi envers une architecture multiséculaire, creuset de mes réflexions de praticienne.
Ainsi ce qui m'est progressivement apparu comme une éthique de la préservation devait progressivement se mettre en place. J'ai élaboré et expérimenté, puis pratiqué une méthode de restauration en accord avec les communautés, une méthode réellement participative, gage de la réussite sur un long terme de projets conçus et réalisés par ceux qui les utilisent quotidiennement. Le plus important, assurément, dans la relation avec une communauté, c'est le respect : non pas un respect naïf qui acquiescerait à toutes les demandes, comme ces parents qui cèdent devant leur enfant capricieux et lui donnent un jouet inutile parce quu'il le réclame à cor et à cri ; mais un respect qui se projette dans les besoins de la communauté sur le long terme et qui cherche à identifier ce qui correspondrait à un mieux-être pour tous. Ce qui implique discussions, conflits, heurts parfois. Sensibilisations toujours, démonstrations ensuite par l'exemple. Mais aussi joies et réussites, avec la satisfaction du partage des espaces restaurés, tournés vers tous, dans un usage renouvelé. La question de la conversion architecturale est un champ ouvert qui se renouvelle pour chaque lieu à réhabiliter. Car ce patrimoine de Ksours (villages fortifiés), igudars (greniers collectifs) est un bien commun souvent habité ou utilisé. Derrière des murs, des architectures, ce sont des pans entiers de patrimoine immatériel qui disparaissent, des possibilités de mieux vivre et de mieux être aussi pour les populations. Ces biens inestimables sont irremplaçables. L'urgence est de sauver les monuments vivants que nous avons la chance de posséder encore au Maroc, mais aussi d'en conserver les procédés, les savoir-faire qui ont permis cette édification, le patrimoine immatériel qui le porte aussi, si fragile et si précieux tout en aidant les populations locales à mieux vivre.
Ecouter, convaincre, relever les architectures, mettre en oeuvre leur préservation
La génération des « modernistes » est fascinée par l'art du lisse, du clinquant, du lifting monstrueux qui transforme ce qui fait les spécificités d'un territoire en un masque gris, sans signes distinctifs. Mon travail essaie de rendre palpable l'idée d'une alternative possible. « Nous ne pensions pas, disent-ils en substance, qu'il était possible de faire aussi beau avec les héritages constructifs des aïeux ». Cette idée simple est une évidence en Europe, alors qu'au Maroc, aujourd'hui, elle tient du miracle. Créer véritablement ce qui répond à ses besoins propres et à son génie propre, à partir de ses spécificités en proposant sa propre voie, en rendant aux communautés leur dignité à travers l'architecture, une architecture résiliente, une architecture de l'adaptation.
Or, ce vieux pays est le produit d'une longue accumulation historique. Chaque monument peut être vu comme un trait de son visage. Tous sont uniques, mais ensemble ils forment un tout et donnent son caractère singulier à chaque territoire ; la diversité y devient générosité. Certains traits sont plus douloureux, ce sont des cicatrices rappelant une histoire malheureuse (la guerre, la misère) à peine refermée parfois, encore en souffrance ; avec le temps ils deviennent comme une ride, marqueur d'un âge vénérable, et ils n'évoquent plus que la sagesse. C'est là sans doute que doit se situer le geste architectural, le plus discret possible au service des êtres qui en sont les usagers premiers.